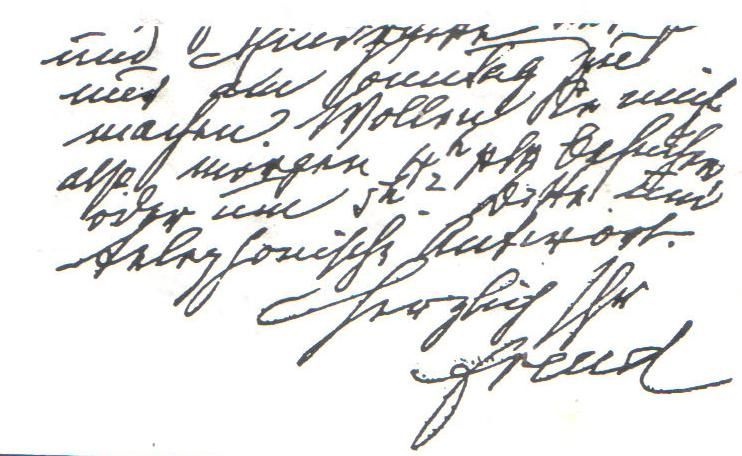Signer la pétition – Voir les signataires
Les signataires de ce texte sont tous concernés par le domaine que le projet d’Institut National des Sciences Humaines et Sociales (INSHS) entend regrouper sous l’appellation « Cognition et comportement ».
Nous sommes étonnés et inquiets de voir que le projet considère que ces domaines relèvent exclusivement des sciences cognitives, constituant les « théories de la complexité » en référent méthodologique central. Il ne fait aucune mention de la philosophie des sciences non naturaliste, de la sociologie, de l’histoire, de l’anthropologie et des sciences politiques. Pourtant, la question de savoir ce que sont précisément la « cognition » et le « comportement » est, à l’évidence, un objet des sciences humaines et sociales : il suffit de penser aux conséquences juridiques et pénales, professionnelles, éducatives (pour ne citer que quelques exemples) de la définition de ce qu’est un comportement, ou aux dimensions collectives, linguistiques, pragmatiques de ce qu’on entend par cognition. Les sciences cognitives n’ont pas le monopole de la cognition.
Pour avoir une idée de l’aveuglement de la nouvelle perspective envisagée, rappelons-nous seulement l’intensité des polémiques qui ont suivi la publication de l’expertise collective de l’INSERM sur le trouble des conduites en 2005 : la définition des comportements anormaux des enfants est apparue immédiatement comme un enjeu de société. Nous sommes étonnés et inquiets de constater l’absence dans le projet des mots-clés santé mentale, psychiatrie, alors que ces domaines sont aujourd’hui, non seulement des préoccupations transversales de nos sociétés, mais encore des objets de conflits.
Peut-on encore sérieusement affirmer que la connaissance du « substrat cérébral » soit la principale chose à considérer pour traiter des questions d’éducation, de santé ou d’organisation du travail ? Les meilleurs spécialistes des neurosciences eux-mêmes s’en gardent bien, et nombreux sont ceux qui souhaiteraient un dialogue approfondi avec des historiens, des sociologues ou des philosophes, précisément sur ces points, afin de procéder à l’indispensable analyse conceptuelle des termes en question : esprit, cerveau, connaissance, comportement.
Le privilège accordé aux approches neuroscientifiques pour parler du comportement relève d’une politique de recherche à courte vue. Une telle approche idéologique ne saurait fonder une politique scientifique digne du futur Institut. S’agit-il de convertir de force la communauté scientifique en sciences humaines et sociales au paradigme cognitiviste ? Nous ne sommes pas appelés à devenir des neurosociologues, des neurophilosophes, des neuroanthropologues ou des neurohistoriens. L’examen concret de la normativité de la vie sociale découverte par l’École sociologique française (Durkheim et Mauss) et la sociologie allemande (Weber) n’est pas une illusion destinée à être remplacée par l’étude de la connectivité cérébrale. C’est un niveau autonome et irréductible de la réalité humaine.
Pourquoi, sans aucun argument explicite en sa faveur, accorder un pareil privilège à un paradigme particulier, naturaliste (ou du moins réductionniste), au détriment d’approches intégratives qui font place aux dimensions sociales de la formation des connaissances (aux contextes socio-historiques, aux institutions, …) ? L’INSHS doit-il mettre un seul paradigme intellectuel en position dominante ? Doit-il rayer d’un trait de plume le pluralisme méthodologique et les débats de la communauté scientifique internationale ? Doit-il enfin compter pour rien l’excellence reconnue des programmes non cognitivistes en SHS ?
Depuis plusieurs années des chercheurs en sciences sociales ont commencé à développer au sein du CNRS notamment, des recherches sur ces sujets. Ils ont constitué un milieu scientifique ouvert et créatif, et ont entamé son internationalisation. Le projet tel qu’il est conçu aujourd’hui mettra fin à cette dynamique. Au-delà, il menace l’existence même des sciences humaines et sociales comme disciplines vivantes, critiques e constructives.
Nous reconnaissons parfaitement l’intérêt des sciences cognitives, et la nécessité qu’elles aient leur place et qu’elles se développent à l’INSHS. De même il nous paraît essentiel de valoriser et de reconnaître les « théories de la complexité » comme un authentique partenaire scientifique dans les sciences humaines et sociales. C’est une condition évidente de la crédibilité scientifique internationale du futur Institut. Mais pour cette raison même, nous refusons leur monopole. Le statut du pôle « Cognition et comportement » tel qu’il est actuellement rédigé consacre la marginalisation d’autres paradigmes d’analyse ou leur insidieuse relégation dans le patrimoine historique.
Nous exigeons donc la réintroduction explicite, dans la mission confiée au pôle « Cognition et comportement », des disciplines qui en ont été exclues, la sociologie, l’histoire, l’anthropologie, la philosophie, l’économie (qui n’est pas une neuroéconomie, pour la plupart des chercheurs) et les sciences politiques afin, tout simplement, que la liberté et la qualité de la recherche soient préservées au sein de l’Institut.
Signer la pétition – Voir les signataires
Les premiers signataires de cet appel sont : Simone Bateman (sociologue, directrice de recherche au CNRS), Jean-François Braunstein (philosophe, Pr à l’université Paris 1), Martine Bungener (économiste, directrice de recherche au CNRS), Pierre-Henri Castel (philosophe, directeur de recherche au CNRS), Jean-Paul Gaudillière (historien, directeur de recherche à l’INSERM, directeur d’études à l’EHESS), Vincent Descombes (philosophe, directeur d’études à l’EHESS), Alain Ehrenberg (sociologue, directeur de recherche au CNRS), Bruno Karsenti (philosophe, directeur d’études à l’EHESS), Sandra Laugier (philosophe, Pr à l’Université de Picardie), Bernard Lahire (sociologue, Pr à l’ENS-LSH), Frédéric Lebaron (sociologue, Pr à l’Université de Picardie), Michel Le Moal (psychiatre et neurobiologiste, membre de l’Académie des sciences), Olivier Martin (sociologue, Pr à l’Université Paris Descartes), Albert Ogien (sociologue, directeur de recherche au CNRS), Bernard Paulré (économiste, Pr Paris 1), François Rastier (linguiste, directeur de recherche au CNRS).