Gérard Haddad est venu nous parler de ses conceptions à propos de l’alcool au féminin lors du colloque de l’Aleph à Lille, cette année. C’est pourquoi, je suis très sensible et heureux d’apprendre que son travail abouti à l’édition de son livre sur le même sujet: “Les femmes et l’alcool, Quatre récits d’un psychanalyste”, chez Grasset.
L’interview que je vous reproduis ci-dessous permet de cerner l’objet de son livre. Il s’inscrit dans le parcours théorique déjà initié avec “Manger le livre”, un ouvrage précédent qui lui permet de penser que l’alcool est un substitut du livre, un équivalent symbolique. “Parce qu’il brule la bouche comme du feu”.
Haddad pose l’utilisation de l’alcool par les femmes comme l’effet d’une “mutilation subie”, la réponse à “un désir bafoué”. Cette réponse du sujet tend vers “un suicide lent et masqué”.
Donc, très logiquement, Haddad nous explique qu’il ne s’agit pas de savoir comment sortir de l’alcool, mais de se demander pourquoi l’on y entre. Ce qui est une position classique des psychanalystes depuis Ferenczi. Ce qui démasque aussi la bêtise de qui voudrait s’aventurer à maitriser la chose.
Haddad fait tourner la catastrophe qui conduit une femme à l’alcool, autour du désastre et de la déroute d’un pacte symbolique qui existerait dans la maternité. Il ne faut pas se tromper sur ses termes. Haddad n’a pas une conception étroite de cette maternité. Il l’élargit à la demande adressée au partenaire qu’il tienne sa place dans le couple. Dans le cas où ce ne serait pas le cas, c’est-à-dire dans celui où le partenaire masculin lui refuserait de pouvoir s’échapper, le refus, la “profanation” de cette autre jouissance équivaudrait à une mutilation.
Ce point est très discutable, il pourrait même nous laisser entrevoir que Haddad a beaucoup de mal à assimiler cette notion compliquée de Lacan. C’est placer la maternité avant tout, même si son désir est impérieux. C’est surtout penser que l’autre jouissance serait contingente, déterminée par ce fameux pacte, s’il existe. Ce dont l’on peut douter.
Et ce n’est pas le recours à un néologisme comme celui de “pa(ma)ternité” qui pourrait nous rassurer là dessus.
Mais, son idée est pourtant intéressante car elle ouvre à une approche inédite de l’alcool pour les femmes. Elle permet à Haddad d’articuler son intuition, étayée par ses observations cliniques, à “la débacle du signifiant paternel dans la société (…) et du livre”. C’est peut-être une piste utile pour la suite de la réflexion.
Enfin, ce livre fait plaisir. Il ouvre les questions et nous change du baratin habituel de nos chers alcoologues.
____________________________________
Gérard Haddad : « Une toxicomanie à portée de main »
LE MONDE, le 18.12.09, Propos recueillis par Josyane Savigneau
Gérard Haddad a été en analyse pendant douze ans avec Lacan, à partir de 1969, et est devenu psychanalyste. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont Manger le Livre (Grasset, 1984), Le Jour où Lacan m’a adopté (Grasset, 2002), et vient de publier Les Femmes et l’alcool. Quatre récits d’un psychanalyste (Grasset, 136 p., 12 euros).
“ Pourquoi cet intérêt pour l’alcoolisme, et spécifiquement celui des femmes ?
Parce que c’est un problème important et de plus en plus grave, une toxicomanie à portée de main, parfois au bas de son immeuble. C’est aussi un problème aux multiples aspects qui n’ont rien de médical, un problème quasi métaphysique.
On se pose souvent la question : comment en sortir ? Rarement celle-ci : pourquoi on « y entre » ? C’est à cette question que j’espère apporter un début de réponse, soumise au public, à la vérification de mes confrères attelés à cette question. Selon moi, la cause de l’alcoolisme est à rechercher dans les impasses et les catastrophes qui surviennent dans l’accession des femmes et des hommes à la fonction, éminemment symbolique, qui règle la reproduction de notre espèce. Impasses survenant chez certains hommes face à la paternité, désastres pour les femmes dans leur désir de maternité. A travers les quatre récits qui forment mon livre, j’ai voulu explorer certaines faces de ces impasses et de ces désastres. Ce n’est peut-être pas la seule cause de l’alcoolisme, mais c’en est une essentielle.
Cette question a fait irruption dans ma pratique, un jour déjà lointain, quand une jeune femme ivre, soutenue par son mari, est entrée dans mon cabinet. Elle consommait depuis quelques mois d’énormes quantités d’alcool. Pourquoi ? Il m’a fallu des mois de patience pour trouver une réponse : au cours d’une opération pour appendicite, le mari avait soudoyé, à l’insu de sa femme, le chirurgien (cela se passe dans un pays lointain) pour qu’il la stérilise. La chose lui est annoncée au réveil. Elle crâne, elle dit qu’ainsi elle ne prendra plus cette pilule qui la gênait. Mais quelques mois plus tard débutèrent les prises massives de whisky. Etrangement cette femme n’établissait aucun lien conscient entre la mutilation subie et son alcoolisme. Je n’ai pas cessé, depuis lors, de penser à cette histoire, devenue pour moi le cas princeps.
Dans d’autres cas, c’est un avortement forcé, c’est-à-dire effectué contre son désir, qui provoque cette addiction chez une femme. C’est l’histoire d’Ilse, rapportée dans Le Livre brisé de Serge Doubrovsky, laquelle, après trois cruels avortements imposés, sombre dans l’alcool jusqu’à en mourir. Mais une femme qui boit ne fait pas le lien entre son désir bafoué et l’addiction qui lui succède quelque temps après. Du même coup, cette cause passe inaperçue. Il m’a fallu des mois pour la mettre au jour.
Selon vous, l’alcoolisme des femmes est différent de celui des hommes. Et pas seulement parce qu’elles en ont honte.
Cela mérite un détour. J’affirme qu’il existe un pacte symbolique fondamental entre hommes et femmes, conséquence de l’universel interdit de l’inceste, qui règle la reproduction de notre espèce. Il n’y a pas d’un côté la paternité aux relents de patriarcat et de l’autre la maternité qui confinerait la femme à ce rôle. C’est une seule et même fonction que j’ai appelée « pa(ma)ternité ». Et ce sont les désastres survenant autour de cette fonction qui peuvent conduire à l’alcool et à la drogue.
Par rapport à ce pacte, la position des hommes et celle des femmes ne sont pas symétriques. Exactement comme l’oedipe féminin n’est pas en miroir de l’oedipe masculin. La femme, avant de se tourner vers le père – et tous les substituts qui le remplaceront – a dû renoncer à son désir pour sa mère, renoncement que Freud appelle castration, placé donc pour elle au début de sa maturation sexuelle. Chez l’homme par contre, cette même castration se situe en fin de son oedipe.
Cette différence de structure détermine les modalités différentes du rapport à l’alcool dans les deux sexes. Pour le dire brièvement, l’homme qui s’adonne à l’alcool est un sujet qui ne parvient pas, ou très mal, à accéder à cette place symbolique de père. Pour la femme, c’est la destruction de son désir ou la profanation de sa fonction symbolique dans la maternité à laquelle elle paraît d’emblée prête, qui cause ce désastre. Or il y a de nos jours une certaine déroute de cette pa(ma)ternité.
Et la femme qui boit est pour vous une femme blessée, profanée dans sa volonté d’être mère.
Il ne s’agit pas de maternité, mais de désir, et pas seulement d’un désir de maternité. C’est aussi le désir que le partenaire dans l’aventure tienne dignement sa place dans le pacte dont je parlais, cela dans l’intérêt de leur commune progéniture. Dans mon livre, je rapporte le cas d’une femme, mère de plusieurs enfants, dont le mari, à un moment de leur histoire, a déchu dans cette dignité, et ainsi a mis en danger leurs enfants. En réaction, elle s’est mise à boire.
Le désir d’accéder à la maternité est généralement clair chez la femme : elle veut ou elle ne veut pas. Quand elle veut, et cela peut venir tard, ce désir est impérieux. Elle y accède d’emblée dans l’angoisse et dans un sentiment d’urgence. Mais si l’homme investi de son amour, de sa confiance, de la totalité de son être, dont elle désire un enfant, la bafoue, la profane dans ce désir, comme dans les cas cités, il se peut alors qu’elle plonge dans l’addiction qui n’est rien d’autre, en définitive, qu’un suicide lent et masqué.
Il y a aussi dans l’amour d’une mère pour son enfant quelque chose d’énigmatique, une jouissance non phallique, comme disait Lacan, qui comparait cette jouissance à celle des mystiques. Et les hommes supportent mal que leur compagne leur échappe dans cette jouissance-là qui n’a rien de biologique et qui lui est indispensable. La lui refuser, c’est la mutiler.
Dans votre livre vous abordez, à travers quatre cas, des questions théoriques.
Si je me suis tant intéressé à ce premier cas, c’est qu’à ce moment-là j’entreprenais un important travail théorique, à mes yeux véritable et profonde transformation de la théorie freudienne classique. Dans la théorie du père chez Freud, telle qu’énoncée dans Totem et tabou, quelque chose ne tient pas. Cette histoire d’un père primitif assassiné puis dévoré par ses fils, cette dévoration cannibalique permettant aux fils l’accès à leur identité, c’est peut-être une intuition géniale mais à reformuler entièrement. Ce que j’ai fait à travers l’analyse des rites alimentaires et ce qui m’a conduit à cette thèse : le sentiment d’identité, d’appartenance à un groupe donné, sans lequel on ne trouve sa place nulle part, et en particulier dans la grande affaire de la reproduction de l’espèce, découle de l’incorporation du Livre fondateur du groupe donné. Cette théorie, je l’ai consignée dans mon essai Manger le Livre. Cette question de l’alcool est venue d’elle-même à travers l’analyse d’ouvrages comme Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry, ou Hedda Gabler, d’Ibsen. Il m’est apparu que l’alcoolique est celui qui n’a pas ou mal incorporé le Livre. L’alcool est un substitut du Livre parce qu’il brûle la bouche comme du feu. Or l’analyse structurale de certains passages bibliques, ceux qui rapportent les visions d’Isaïe, d’Ezéchiel et l’Apocalypse de Jean, m’a montré que le feu est l’équivalent du Livre, du symbolique. Ce sont des questions qu’on ne peut résumer en quelques lignes. Ce livre Les Femmes et l’alcool prolonge la réflexion entamée dans Manger le Livre.
Plus généralement, d’où vient l’alcoolisme des jeunes gens aujourd’hui ?
Cela me paraît en relation directe avec ce que nous disions. L’extension des addictions est une conséquence de la débâcle du signifiant paternel dans notre société, débâcle de la pa(ma)ternité, débâcle du symbolique et du Livre ”.


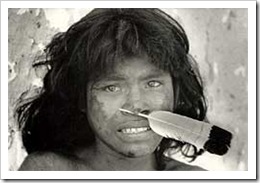
 es psychothérapies durant au moins un an paraissent plus efficaces pour traiter des pathologies mentales complexes que des interventions de courte durée recourant plus intensivement à des médicaments, selon une méta-analyse publiée mardi.
es psychothérapies durant au moins un an paraissent plus efficaces pour traiter des pathologies mentales complexes que des interventions de courte durée recourant plus intensivement à des médicaments, selon une méta-analyse publiée mardi.